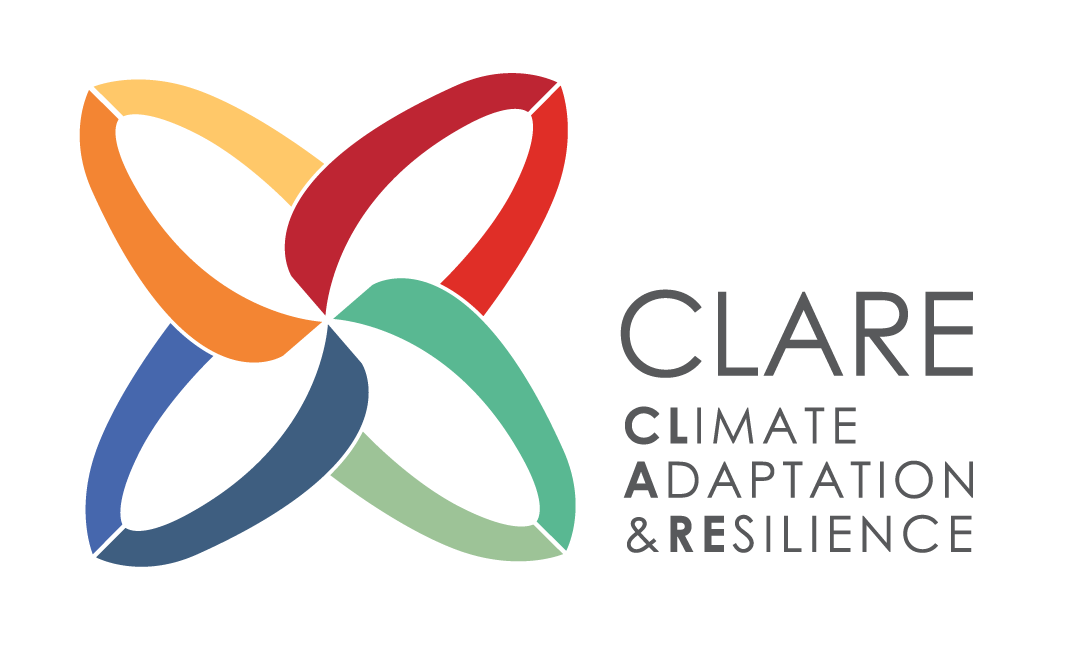Au-delà de la liste de vérification : Repenser le genre, la justice et la recherche dans un monde en mutation
/
Auteures : Reetika Revathy Subramanian et Nitya Rao, SUCCESS
Séparés par les océans, les langues et les fuseaux horaires, mais liés par des histoires communes de patriarcat, de colonialisme et de dérèglement climatique, les chercheurs de cinq projets CLARE se sont réunis du 18 au 20 juin 2025 à l’université d’East Anglia. Ce qui nous a réunis, ce n’est pas seulement un intérêt commun pour la recherche, mais un malaise partagé face à la façon dont le genre est si souvent réduit à une case à cocher dans le travail de développement. Nous ne sommes pas venus pour présenter des résultats polis. Nous sommes venus pour nous interroger, les uns les autres et nous-mêmes, sur la manière dont les connaissances sont produites, sur les voix qu’elles amplifient et sur la manière dont la recherche peut être plus qu’un rapport de plus qui prend la poussière sur une étagère.
Nous avons participé à la conférence « Genre et développement : Débats pour un monde en mutation », co-dirigée par la professeuse Nitya Rao de la School of Global Development, qui est également membre du projet de recherche SUCCESS soutenu par CLARE. L’événement s’est ouvert par un atelier d’une journée destiné aux chercheurs du projet CLARE et a rassemblé, au cours des deux jours suivants, près d’une centaine d’universitaires spécialistes des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, issus de disciplines, de pays et de générations différents. Par le biais de panels, de discussions et de sessions créatives, la conférence est devenue un espace non seulement d’échange académique, mais aussi de véritable réflexion sur la situation actuelle des études de genre et sur leurs perspectives d’avenir. Le sentiment que les études de genre sont en train de changer est très fort. Au-delà des questions d’identité, les jeunes féministes posent des questions plus difficiles sur la guerre, le changement climatique, l’IA, la surveillance numérique, l’autoritarisme et les systèmes plus larges qui façonnent nos vies. Dans le même temps, le domaine lui-même se sent menacé. Réduction des financements, fermeture de programmes, pressions politiques, censure.
Pour Grace, Helen, Samiksha, Jahin, Tyas, Rashed, Nitya et moi-même, il ne s’agissait pas d’une conférence standard avec des présentations soigneusement élaborées. Il s’agissait plutôt d’une série de conversations honnêtes, parfois difficiles, entre des personnes travaillant en première ligne sur la vulnérabilité climatique, les déplacements, la gouvernance, le travail et les droits fonciers. Certains d’entre nous ont travaillé sur l’adaptation côtière au Bangladesh, d’autres sur les conflits fonciers au Nigeria, la pêche en Indonésie ou le travail industriel au Bhoutan. Nos contextes différaient, mais certaines questions revenaient sans cesse à l’esprit. Comment les systèmes de pouvoir, qu’ils soient fondés sur le sexe, la race ou l’économie, façonnent-ils la capacité des gens à survivre, à résister et à s’adapter ? Et qu’est-ce que cela signifie pour nous, en tant que chercheurs, d’être pris dans ces dynamiques ? Jahin a fait part de ses réflexions sur le projet SURF-IT, dans le cadre duquel les communautés et les scientifiques du Bangladesh coproduisent des informations sur le climat. Samiksha a parlé de son expérience de l’utilisation de photovoice avec différentes parties prenantes au Bhoutan pour faciliter une communication non menaçante dans l’élaboration d’interventions autour de la migration en tant qu’adaptation (SUCCESS).
L’un des thèmes qui est revenu sans cesse à l’esprit est celui de la responsabilité. Non pas celle exigée par les bailleurs de fonds ou les institutions universitaires, mais celle que nous devons aux personnes avec lesquelles nos recherches ont un impact sur la vie. Encore et encore, nous nous sommes demandé pour qui nous faisions vraiment cela. La publication suffit-elle ? Ou devrions-nous créer des espaces de dialogue qui dépassent les cercles académiques ? L’un de nos moments préférés a été la journée que nous avons passée au laboratoire des médias de l’UEA, à expérimenter non seulement des formats, mais aussi nos propres voix. Nous avons enregistré des podcasts qui n’essayaient pas d’emballer les histoires proprement, mais qui ouvraient la nature désordonnée et compliquée de la connaissance et de ceux dont les voix sont entendues.
Un autre fil conducteur a été le rejet discret mais ferme de la manière dont la résilience est souvent romancée. À maintes reprises, nous avons partagé des histoires qui s’opposaient à l’idée que la résilience était une qualité héroïque que les femmes en marge possédaient naturellement. Les réalités sont plus dures, plus crues et bien plus complexes. Au Nigeria, Helen a raconté que les filles des communautés d’éleveurs étaient mariées jeunes, les familles essayant de les protéger de la violence croissante. En Indonésie, Tyas a expliqué comment les femmes travaillant dans la pêche artisanale étaient exclues des plans d’adaptation alors même que leurs moyens de subsistance ne tenaient qu’à un fil. Au Bangladesh, Rashed a décrit comment les femmes déplacées parcouraient de plus longues distances pour trouver de l’eau alors que les chocs climatiques s’accumulaient. Au Népal, j’ai partagé les résultats de nos recherches en cours sur la façon dont les femmes s’opposent lentement à la gouvernance patriarcale, en assumant des rôles de leadership dans des endroits où elles ont longtemps été mises à l’écart.
Ces femmes ne se contentaient pas de survivre. Elles négociaient, résistaient, s’adaptaient, souvent à leurs propres dépens. Leur résilience était réelle, mais il ne s’agissait pas d’une chose à romancer ou à transformer en un slogan rassurant. En écoutant ces histoires, nous nous sommes interrogés sur notre propre rôle dans la manière dont ces récits sont racontés. Comment nous assurer que nous amplifions les voix et que nous ne parlons pas par-dessus elles ? Comment rester fidèles aux expériences vécues par les gens sans les aplatir dans des extraits sonores ou des notes de synthèse ?
Ce qui nous a le plus frappés, c’est qu’aucun d’entre nous n’a abordé ces questions de la même manière. Nous ne partagions pas une méthode ou un point de vue unique. Mais nous partagions quelque chose de plus important, une volonté de s’asseoir avec des questions difficiles et de résister à l’envie de trouver des réponses faciles. Le changement climatique, l’inégalité entre les hommes et les femmes et l’injustice systémique ne donnent pas lieu à des conclusions précises. Au lieu de prétendre que c’est le cas, nous nous sommes penchés sur l’inconfort. Nous nous sommes demandé ce que cela signifie vraiment de faire ce genre de travail avec intégrité, en particulier lorsque nous travaillons souvent au sein même des systèmes que nous cherchons à critiquer.
Lorsque nous avons quitté Norwich, ce n’était pas avec de grandes déclarations ou des réponses définitives. Nous sommes partis avec un objectif plus clair et une compréhension commune du fait que la solidarité ne consiste pas à être toujours d’accord, mais à rester en conversation, même lorsque c’est difficile. Bien que nous soyons maintenant de retour dans des endroits différents, nous restons liés par les souvenirs que nous avons créés – en marchant le long de l’UEA Broad, en partageant des rires dans le laboratoire des médias et en discutant d’idées pendant la conférence.
Catégories
Pays
Piliers de CLARE
Thèmes de CLARE
Sujets de CLARE
Publié
Projets CLARE
Partenaires de CLARE